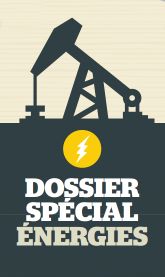
DOSSIER SPÉCIAL
L’ALBERTA CHERCHE SON ÉQUILIBRE
L’Alberta traverse un moment charnière de son histoire énergétique. Entre ambitions économiques, pressions environnementales et tensions fédérales-provinciales, la province cherche à rester chef de file. Ce dossier explore les multiples visages de cette transformation : des technologies de captage du carbone aux grands projets d’oléoducs, en passant par le ralentissement des énergies renouvelables.

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, essaie de faire approuver son projet d’oléoduc vers le nord-ouest de la Colombie-Britannique par le Bureau des grands projets d’ici la mi-novembre. Photo : Courtoisie
La première ministre albertaine Danielle Smith a déjà annoncé que plusieurs «mesures restrictives» sur les émissions et le transport par pétrolier devront être annulées ou revues par Ottawa pour permettre au projet d’aller de l’avant et attirer l’investissement d’une entreprise privée.
«Le premier ministre Mark Carney s’est engagé auprès de la première ministre Smith à rechercher une entente concernant un oléoduc, le projet Pathways et la fin des politiques antérieures jugées hostiles au secteur énergétique. Nous espérons atteindre cet objectif d’ici la Coupe Grey, en novembre», mentionne le ministère de l’Énergie et des Mines dans une communication écrite envoyée à la rédaction.
Pourquoi l’Alberta réclame-t-elle un changement de cap fédéral?
- La Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers (C-48), adoptée en 2019, impose un moratoire sur les pétroliers et bloque de facto l’accès à plusieurs ports du nord de la Colombie-Britannique.
- Le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, instauré par le gouvernement Trudeau en 2016, vise la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces règles, qui touchent directement le secteur pétrolier et gazier, compliquent tout soutien fédéral à une nouvelle expansion du transport du bitume.
Pour l’instant, c’est le gouvernement provincial qui agit à titre de promoteur du projet et prévoit d’investir 14 millions de dollars pour élaborer une demande officielle. Cette situation traduit en quelque sorte la prudence du secteur privé, encore échaudé par les contestations et dépassements de coûts des projets d’oléoducs récents.
L’expansion du réseau Trans Mountain, qui a été mis en service en mai 2024 après des années de contestation, en est un exemple éloquent. Le gouvernement canadien avait dû racheter le projet à Kinder Morgan en 2018 pour en assurer l’achèvement.
Le projet Northern Gateway, qui devait, lui aussi, relier l’Alberta à la Colombie-Britannique, a été abandonné en 2016, à la suite d’une décision de la Cour d’appel fédérale. Les juges avaient conclu à une consultation inadéquate des communautés autochtones et à une évaluation environnementale insuffisante. La forte opposition des chefs autochtones et des défenseurs de l’environnement avait aussi joué un rôle déterminant dans son annulation. Et une opposition similaire semble déjà se reformer autour du projet actuel.
Des oppositions se reforment
Les nations autochtones côtières ont récemment réaffirmé leur position contre la construction d’un oléoduc sur leurs territoires. Dans un communiqué publié le 1er octobre, Marilyn Slett, présidente de la Coastal First Nations, une alliance de plusieurs communautés de la région, et cheffe élue de la Nation Heiltsuk, a déclaré que les nations côtières n’appuieront «aucun projet de pipeline ni de transport de pétrole dans [leurs] eaux».
L’Union of British Columbia Indian Chiefs (UBCIC) partage cette position. Son président, le grand chef Stewart Phillip, voit dans ce projet une attaque directe contre les droits constitutionnels des Premières Nations. «Toute proposition visant à imposer un nouvel oléoduc jusqu’à la côte nord de la Colombie-Britannique constitue une attaque directe contre les titres et droits inhérents et constitutionnels des Premières Nations, gardiennes de ces terres et ces eaux», mentionne-t-il.
Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a lui aussi mentionné qu’il ne soutiendrait pas un tel projet et a demandé au gouvernement fédéral de réaffirmer son soutien à l’interdiction de circulation des pétroliers au large de la côte ouest.

Adebayo Majekolagbe est professeur adjoint à la Faculté de droit de l’Université de l’Alberta. Photo : Courtoisie
Un cadre juridique clair
Or, sur le plan juridique, les marges de manœuvre des nations autochtones comme du gouvernement britanno-colombien demeurent «limitées», explique Adebayo Majekolagbe, professeur adjoint à la Faculté de droit de l’Université de l’Alberta.
«La Constitution est très claire quant à la compétence exclusive que détient le gouvernement fédéral en ce qui concerne les pipelines interprovinciaux. Cela est clairement énoncé à l’article 92(10) de la Loi constitutionnelle de 1867», mentionne-t-il dans une entrevue.
Bien que cette disposition n’oblige en rien le fédéral à aller de l’avant avec le projet, précise-t-il, elle indique «clairement» que le gouvernement de Mark Carney n’a pas besoin de «l’autorisation ni même de la coopération» de la Colombie-Britannique pour approuver un projet d’oléoduc interprovincial.
Le poids du droit constitutionnel
Le chercheur rappelle d’ailleurs que la Cour suprême du Canada a réaffirmé ce principe à plusieurs reprises. Le précédent le plus pertinent demeure, selon lui, celui de l’Environmental Management Act, lié au doublement du pipeline Trans Mountain. En 2019, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique avait jugé invalide une disposition obligeant le promoteur à obtenir un permis provincial avant la construction. La Cour suprême a ensuite entériné cette conclusion en rappelant que le fédéral détient une compétence exclusive sur les pipelines reliant plusieurs provinces et donc qu’un permis provincial n’était pas nécessaire.
Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Canada affirme partager cette interprétation. Dans une déclaration écrite envoyée à la rédaction, le ministère confirme que le gouvernement fédéral a compétence sur les ouvrages qui relient des provinces ou dépassent les frontières provinciales, y compris les pipelines interprovinciaux.
«La compétence fédérale dans ces domaines assure une approche cohérente à l’échelle du pays pour les infrastructures d’importance nationale, tout en respectant les droits provinciaux et autochtones. L’approche fédérale repose sur le partenariat et la prévisibilité, afin que les projets avancent d’une manière conforme à l’intérêt national et aux obligations juridiques», écrit un porte-parole.
La Constitution est très claire quant à la compétence exclusive que détient le gouvernement fédéral en ce qui concerne les pipelines interprovinciaux.
Une loi controversée
Adopté à l’été 2025, le projet de loi C-5 (Loi sur l’unité de l’économie canadienne) ajoute une autre couche de complexité. Cette loi censée accélérer la réalisation de projets d’infrastructure d’intérêt national permet au Cabinet du premier ministre (du Canada) de passer outre certaines lois existantes pour inscrire un projet, tel que l’oléoduc proposé par l’Alberta, à la liste des grands projets fédéraux. Plusieurs groupes environnementaux et dirigeants autochtones y voient une dérive, estimant que le projet de loi affaiblit les processus de consultation et d’évaluation environnementale au profit de la rapidité.
Pourtant, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Tim Hodgson, a semé la confusion en déclarant publiquement que le projet d’oléoduc albertain devrait obtenir «le soutien de la juridiction traversée», suggérant que l’Alberta et la Colombie-Britannique devraient s’entendre avant que la construction puisse aller de l’avant.
Cette déclaration a fait bondir plusieurs observateurs, dont le chef de l’opposition, Pierre Poilievre, qui y voit une contradiction avec la compétence fédérale exclusive sur les oléoducs interprovinciaux. «Le gouvernement fédéral vient d’inventer un faux veto provincial pour le premier ministre de la Colombie-Britannique», a-t-il dénoncé dans un communiqué.
L’Alberta revendique son droit d’exporter
Malgré les signaux prudents envoyés par Ottawa, le ministre de l’Énergie et des Mines de l’Alberta, Brian Jean, se dit confiant que le gouvernement fédéral exercera pleinement sa compétence constitutionnelle afin de permettre la construction d’un nouvel oléoduc interprovincial vers la côte nord-ouest.
«La demande pour notre pétrole produit de manière responsable ne cesse de croître en Asie, notamment en Chine, en Inde, en Corée du Sud et au Japon. Si l’objectif du premier ministre Mark Carney est de faire du Canada une superpuissance énergétique, la construction d’un nouvel oléoduc vers la côte nord-ouest représente la meilleure façon d’en maximiser la valeur pour le pays», mentionne-t-il dans une communication écrite.
La demande pour notre pétrole produit de manière responsable ne cesse de croître en Asie, notamment en Chine, en Inde, en Corée du Sud et au Japon.

Selon l’Alberta, la demande pour son pétrole ne cesse de croître en Asie. Photo : Arnaud Barbet
Signaux contradictoires?
Pour le gouvernement de l’Alberta, la construction de l’oléoduc s’inscrit dans une logique économique et nationale. Selon la province, Ottawa doit mettre en œuvre les pouvoirs qui lui reviennent afin de soutenir l’exportation du pétrole canadien.
Or, cette posture met en lumière une certaine contradiction dans la stratégie albertaine, observe le professeur Adebayo Majekolagbe. D’un côté, la province sollicite l’intervention du fédéral pour faciliter l’exportation de son pétrole, de l’autre, elle revendique régulièrement son autonomie face à Ottawa.
«L’Alberta semble avoir adopté une position opportuniste, parce qu’elle veut exporter son pétrole, observe-t-il. Elle va à l’encontre de la position qu’elle défend habituellement en faveur de l’autonomie provinciale.»
Selon lui, ce revirement pourrait même se retourner contre la province. En appelant Ottawa à exercer ses pleins pouvoirs, l’Alberta pourrait légitimer l’autorité fédérale sur les dossiers énergétiques et créer un précédent qui pourrait lui nuire dans ses projets à venir.
Les communautés autochtones au cœur du débat
Si la question des compétences alimente les échanges politiques depuis un mois, c’est toutefois ailleurs que pourrait se jouer l’avenir du projet, soit dans la capacité des gouvernements à respecter leurs obligations constitutionnelles envers les peuples autochtones.
Selon le chercheur Adebayo Majekolagbe, cette dimension juridique est incontournable. «Même si le fédéral détient la compétence, d’autres éléments entrent en jeu, souligne-t-il. Le promoteur du projet, en l’occurrence l’Alberta, a le devoir de consulter les communautés autochtones concernées et d’apporter des accommodements lorsque nécessaire. Il s’agit d’une exigence constitutionnelle.»
La jurisprudence actuelle limite toutefois la portée de ce devoir. Par exemple, les gouvernements ou les titulaires de droits autochtones ne disposent pas d’un droit de veto sur quelconque projet. «Le gouvernement fédéral doit mener une véritable consultation et tenir compte des résultats, mais il n’est pas tenu d’obtenir leur consentement, malheureusement», ajoute-t-il.
Par contre, en vertu de l’article 22 de la Loi sur l’évaluation d’impact, qui a été modifiée en 2024, les peuples autochtones peuvent désormais réaliser leur propre évaluation des impacts d’un projet et le gouvernement est tenu de l’inclure comme facteur dans son processus décisionnel.
«Ça leur donne une plus grande autonomie. Le gouvernement fédéral doit tenir compte de la position des titulaires de droits autochtones afin de déterminer si un projet sert l’intérêt public. Ça pourrait influencer la décision dans le cas du nouveau projet d’oléoduc», analyse-t-il.
De son côté, le ministère de l’Énergie et des Mines de l’Alberta soutient que la participation des communautés autochtones constitue un élément essentiel de son projet d’oléoduc vers la côte nord-ouest. «La participation autochtone est une priorité et pourrait se traduire par une participation à la propriété, comme on l’a vu dans d’autres projets énergétiques.»
Selon le gouvernement albertain, les représentants d’une douzaine de communautés autochtones auraient déjà été rencontrés, dont une petite moitié en personne. Mais cette volonté de dialogue ne suffit pas à dissiper les inquiétudes. Si certaines organisations, comme la National Coalition of Chiefs, appuient le projet en y voyant une source potentielle de prospérité économique, la majorité des nations continuent de s’y opposer fermement.
En fait, ce nouvel oléoduc pourrait mettre une fois de plus à l’épreuve la fragile équation entre développement énergétique et réconciliation en Alberta et au Canada.

Une raffinerie située dans la ville de Lloydminster. Photo : Archives Le Franco – Arnaud Barbet
Créé à l’automne 2025, le Bureau des grands projets vise à accélérer l’examen des projets jugés d’intérêt national.
Glossaire – Promoteur : Personne ou organisation qui donne la première impulsion à un projet










