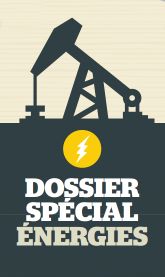
DOSSIER SPÉCIAL
L’ALBERTA CHERCHE SON ÉQUILIBRE
L’Alberta traverse un moment charnière de son histoire énergétique. Entre ambitions économiques, pressions environnementales et tensions fédérales-provinciales, la province cherche à rester chef de file. Ce dossier explore les multiples visages de cette transformation : des technologies de captage du carbone aux grands projets d’oléoducs, en passant par le ralentissement des énergies renouvelables.

Ian Sanderson est analyste principal au Pembina Institute. Photo : Pembina
Dans l’industrie pétrolière albertaine, le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC) est perçu comme l’un des outils les plus crédibles pour réduire massivement les émissions. «En termes de réduction à grande échelle, c’est la technologie la plus prometteuse dont dispose le secteur pour l’instant», souligne Ian Sanderson, analyste principal au Pembina Institute.
Concrètement, le CUSC permet de capturer le CO₂ directement aux sources industrielles, comme les raffineries ou les installations de valorisation du bitume, avant qu’il ne soit relâché dans l’atmosphère. Le gaz est ensuite acheminé par oléoduc vers des formations géologiques profondes où il peut être stocké de manière permanente.
«Si on adopte le captage du carbone à grande échelle, par exemple dans les centrales au gaz naturel, cela permettrait de réduire le coût de la technologie, tout en développant une véritable économie autour d’elle. On bâtirait ainsi l’expertise et la main-d’œuvre nécessaires», analyse M. Sanderson.
Pour accélérer cette transition, les gouvernements canadien et albertain ont d’ailleurs instauré plusieurs incitatifs, comme un crédit d’impôt fédéral couvrant jusqu’à 50% des coûts d’investissement et une aide additionnelle de 12% offerte par l’Alberta. Mais malgré ces mesures, les projets tardent à se concrétiser.
«Les gouvernements ont fait leur part, mais c’est à l’industrie de prendre la décision d’investir et elle hésite encore», observe l’expert. Selon lui, cette prudence s’explique autant par les coûts initiaux importants que par le manque de stabilité du prix du carbone, qui compromet la rentabilité à long terme des projets.
«C’est une technologie coûteuse, et c’est pourquoi on ne la voit pas encore adoptée à grande échelle, ni en Alberta, ni ailleurs dans le monde», indique-t-il.
Une lueur demeure
Néanmoins, le projet phare de la Pathways Alliance, un consortium réunissant les six plus grands producteurs de sables bitumineux, nourrit encore l’espoir d’une industrie moins polluante.
L’initiative prévoit la capture du CO₂ sur plus d’une dizaine de sites industriels et son acheminement par un oléoduc d’environ 400 kilomètres jusqu’à une zone d’entreposage située près de Cold Lake. Le consortium estime que cette infrastructure pourrait permettre de réduire jusqu’à 22 mégatonnes de CO₂ par année.
À titre de comparaison, l’Alberta a émis 270 mégatonnes de dioxyde de carbone en 2022, soit environ 38% des émissions totales du Canada.
Toujours en développement, le projet pourrait voir le jour d’ici 2030. «Les membres de Pathways Alliance ont réalisé d’importants progrès», mentionne par écrit son président, Kendall Dilling. Il précise que l’ingénierie de conception (front-end engineering design – FEED) a été achevée en 2024 et que 58 demandes de droit de passage sur des terres de la Couronne ont été déposées auprès de l’Alberta Energy Regulator, l’organisme provincial chargé de réglementer l’ensemble des activités liées à l’énergie en Alberta.
Les processus de consultation et de mobilisation se poursuivent également auprès des groupes autochtones. «La collecte d’informations sur l’utilisation traditionnelle des terres est amorcée et la planification des mesures d’atténuation le long de l’emprise du pipeline est en cours», ajoute M. Dilling.
Bras de fer politique
Le projet de Pathways Alliance cristallise aussi les tensions sur la voie à suivre pour décarboniser le secteur pétrolier. Ces derniers mois, la première ministre Danielle Smith a évoqué l’idée d’un «grand bargain», un compromis selon lequel l’appui d’Ottawa au réseau de captage et de stockage du carbone serait lié à la relance de son projet d’oléoduc vers la côte nord de la Colombie-Britannique.
Cette proposition a été jugée inappropriée par plusieurs experts, dont Ian Sanderson, puisqu’elle associe un projet de réduction des émissions à une expansion du transport pétrolier. «Ce sont deux dossiers totalement distincts qui ne devraient pas être confondus», insiste ce dernier.
Selon lui, le projet de captage et de stockage du carbone proposé en 2021 par Pathways Alliance a été conçu pour être viable sans nouvelle expansion des exportations. Et ce plan devrait demeurer inchangé. «C’est justement le projet de grande ampleur qu’on attend qui pourrait véritablement transformer un secteur qui peine depuis longtemps à réduire son empreinte carbone», précise-t-il.
Il rappelle également que la moitié du financement du projet provient déjà de fonds publics et que l’industrie doit être en mesure d’assumer sa juste part. «Mais je le rappelle, s’il y a de la résistance, c’est aussi parce que c’est un projet énorme et très coûteux. Pour vous donner une idée, ce serait le plus gros projet au monde dans le genre», ajoute M. Sanderson.
Selon les estimations, l’investissement nécessaire serait d’environ 16,5 milliards de dollars.
Retirer le carbone directement de l’air
Si le captage industriel promet de limiter les émissions futures, d’autres approches cherchent maintenant à corriger celles du passé en retirant directement le CO₂ de l’atmosphère.
Le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC), ainsi que le retrait direct du dioxyde de carbone (DAC) poursuivent le même objectif, c’est-à-dire réduire la concentration de dioxyde de carbone (CO₂), mais par des voies très différentes. La première intercepte les émissions à la source, avant même qu’elles ne soient relâchées dans l’air, tandis que la seconde s’attaque directement au carbone déjà présent dans l’atmosphère.

Carson Fong est gestionnaire du programme de retrait direct du dioxyde de carbone au Pembina Institute. Photo : Pembina
«Nous devons d’abord réduire les émissions de manière soutenue avec les outils que l’on connaît déjà», explique Carson Fong, gestionnaire du programme de retrait direct du dioxyde de carbone (DAC) au Pembina Institute. Mais le retrait direct peut être fort utile pour «contrebalancer les émissions résiduelles et à retirer le CO₂ accumulé depuis la révolution industrielle», ajoute-t-il.
Et l’Alberta possède, selon lui, plusieurs atouts pour devenir un chef de file mondial dans ce domaine, soit une infrastructure de stockage géologique déjà développée et des ressources abondantes en énergie renouvelable. «Ces conditions rendent la province particulièrement propice au déploiement de projets de captage direct», note-t-il.
Nous devons d’abord réduire les émissions de manière soutenue avec les outils que l’on connaît déjà.

Pierre-Olivier Vincent est le chef des projets d’investissement chez Deep Sky. Photo : Courtoisie
Laboratoire à ciel ouvert
Mais encore faut-il tester ces technologies sur le terrain pour en mesurer le potentiel réel. C’est précisément ce que fait Deep Sky, à Innisfail, une ville située à une trentaine de kilomètres de Red Deer, où l’entreprise montréalaise pilote le premier projet de captage direct d’air à grande échelle au pays.
«L’Alberta nous a offert un terrain d’expérimentation idéal, avec un cadre réglementaire clair. On a aussi l’appui du gouvernement», explique Pierre-Olivier Vincent, chef des projets d’investissement. «La province a des intérêts de se positionner au niveau canadien et mondial comme un centre de développement en matière de capture», ajoute-t-il.
Soutenue par un financement de 5 millions de dollars de l’organisme Emissions Reduction Alberta, l’usine doit entrer en activité en novembre 2025. Elle deviendra le premier centre au monde à tester simultanément dix technologies de captage direct afin de déterminer lesquelles s’adaptent le mieux au climat froid et sec de la province.
«C’est une très bonne approche. À ce stade, il faut expérimenter, voir ce qui fonctionne et s’adapter rapidement», observe Carson Fong, qui y voit une étape essentielle pour faire progresser l’innovation.
Les émissions capturées par Deep Sky seront vendues sous forme de crédits à des entreprises souhaitant compenser leurs émissions. Cette approche attire cependant quelques critiques, puisque certains estiment que les crédits sont parfois vendus plus vite que le carbone n’est réellement retiré.
«Ce ne sont pas les pétrolières qui achètent nos crédits, du moins pas pour l’instant», précise Pierre-Olivier Vincent. Nos clients sont des entreprises comme Microsoft ou la Banque Royale du Canada, qui veulent atteindre leurs cibles climatiques.»
Un processus à perfectionner
Le processus utilisé par Deep Sky consiste à capturer le CO₂, à le liquéfier et à le stocker temporairement sur place avant son transport vers un puits d’injection près d’Edmonton. Pour le moment, l’usine vise une capacité de capture de 3000 tonnes par an, «une goutte dans l’océan», sachant que le Canada a lui seul a produit 694 mégatonnes en 2023, reconnaît le chef des projets d’investissement.
Mais l’entreprise voit cette première étape comme l’occasion de tester la viabilité de son modèle. «Cette usine se veut démonstrative», souligne M. Vincent. «L’objectif est de prouver l’efficacité des technologies avant de construire des installations cent fois plus grandes dans les prochaines années. La prochaine étape, c’est une usine de 500 000 tonnes», conclut-il.

L’entreprise mise sur un processus qui réunit dix technologies simultanément pour retirer le carbone de l’atmosphère. «Ça fonctionne comme une grosse éponge qui se sature de CO₂», précise Pierre-Olivier Vincent. Photo : Deep Sky
Un défi énergétique majeur
Malgré l’enthousiasme qu’il suscite, le principal obstacle du captage direct demeure sa forte consommation d’énergie. «Le processus demande beaucoup d’électricité et on ne peut pas se permettre de l’alimenter avec de l’énergie issue du charbon. Notre objectif est de nous appuyer sur des sources entièrement vertes, comme l’éolien, le solaire ou l’hydroélectricité», reconnaît M. Vincent. Ces énergies renouvelables ne sont toutefois pas toujours disponibles en continu, précise-t-il.
Glossaire – Incitatif : Mesure qui stimule l’action










