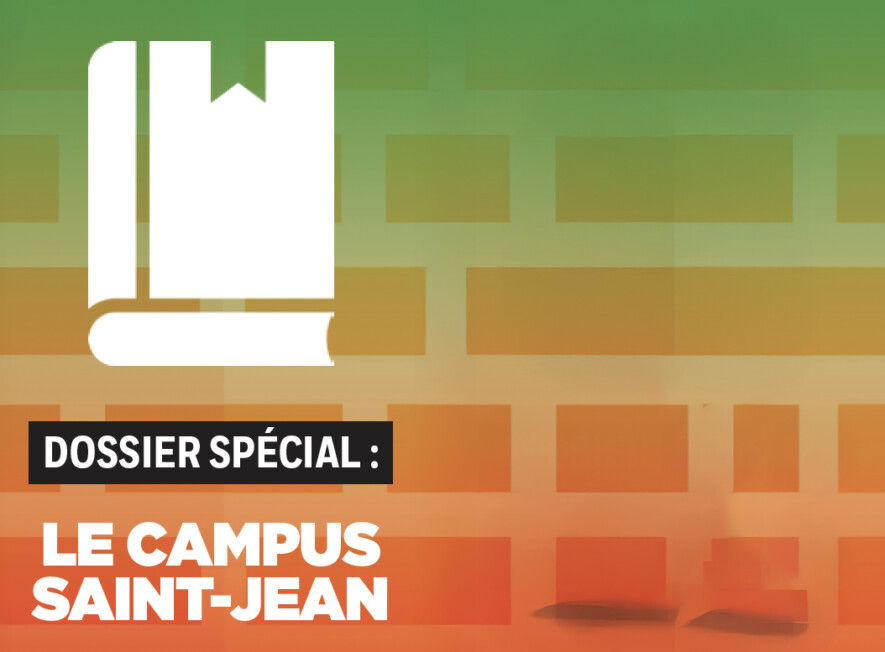DOSSIER SPÉCIAL
Le Campus Saint-Jean, entre continuité et transformations
Depuis 1908, le Campus Saint-Jean continue d’être un pilier important de la francophonie albertaine. Ce dossier explore les enjeux et dynamiques que traversent actuellement l’institution, et plus largement, le milieu universitaire en Alberta. De la formation en ligne à l’intégration des nouveaux arrivants sur le marché du travail grâce à un programme offert au Campus, en passant par le recours judiciaire toujours en cours entre l’ACFA, l’Université de l’Alberta et le gouvernement provincial, plusieurs volets sont mis en lumière (retrouvez 5 articles dans nos pages).
IJL – RÉSEAU.PRESSE – LE FRANCO

David Cloutier, un diplômé du programme de maîtrise ès arts en études interdisciplinaires à l’Université d’Athabasca. On le voit ici en train d’étudier dans le confort de sa cuisine, à son domicile de Calgary. Photo : Courtoisie
«C’est loin d’être la panacée», prévient d’entrée de jeu Florian Meyer, professeur au département de pédagogie de la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke et spécialiste de la formation à distance. Entre fatigue numérique, risque de plagiat et désengagement des apprenants, il souligne que l’enseignement virtuel peut présenter son lot de complexités.
«Les apprenants sont isolés à distance. Ils sont seuls, ils ont besoin d’avoir les repères les plus clairs possibles pour fonctionner de manière autonome. Sans ça, ils vont perdre leur chemin et le sens de ce qu’ils font», mentionne-t-il.
C’est pourquoi il préconise une approche pédagogique qui mise sur le sentiment de présence chez ses étudiants. «Il faut privilégier des pédagogies actives qui les engagent au niveau cognitif, les amènent à réfléchir et à se questionner», souligne-t-il. Selon lui, les étudiants sont «bien plus motivés» lorsqu’ils sont encouragés à remettre en question des idées et à échanger entre pairs, plutôt que de rester passifs devant un écran.
Malgré ces enjeux, Florian Meyer demeure convaincu que l’enseignement à distance a beaucoup à offrir. «Il faut penser à l’augmentation de l’accessibilité. Ça permet de rejoindre des étudiants qui habitent des régions éloignées, qui peuvent rester dans leurs communautés tout en ayant accès aux mêmes savoirs», fait-il valoir.

Martin Poirier est gestionnaire du Campus Satellite de Calgary. Photo : Derek Denett
Cours à distance, un plus pour la francophonie
Au Campus Saint-Jean, les programmes à distance offrent aussi la possibilité aux francophones de l’Ouest canadien de suivre des cours dans leur langue, sans avoir à se délocaliser. Pour l’instant, seul le baccalauréat en éducation est offert en ligne, mais, face au succès rencontré, d’autres programmes pourraient éventuellement voir le jour, indique Martin Poirier, gestionnaire du campus satellite de Calgary.
«Ça fait seulement trois ans qu’on a commencé. On cherche d’abord à établir solidement le programme en éducation et à offrir de plus en plus de cours spécialisés. Mais à plus long terme, on veut aussi développer d’autres programmes», explique-t-il.
Le Campus se base sur un système comodal, c’est-à-dire que l’enseignement est offert simultanément en personne, à Calgary, et à distance afin de maximiser la flexibilité. Lors de l’année scolaire 2024-2025, 130 étudiants y étaient inscrits, dont 58 suivaient leurs cours en ligne depuis des régions éloignées de l’Alberta, mais aussi de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et du Manitoba.
«Il y a tellement de demandes pour des enseignants francophones à travers le pays avec la [pénurie] que l’on connaît. L’objectif, c’est d’élargir le bassin, sans obliger les étudiants à se délocaliser. On veut les garder dans les régions, où il est plus difficile de [pourvoir] des postes», souligne Martin Poirier.
Le programme devrait franchir la barre des 200 étudiants l’an prochain, avec une proportion similaire à celle de cette année, soit environ 40% d’apprenants en ligne.
La formation en ligne ne date pas d’hier
Si plusieurs universités ont pris un virage vers le numérique depuis la pandémie, l’Université d’Athabasca (AU), quant à elle, se distingue comme chef de file en matière de formation à distance depuis plusieurs décennies. Située dans le nord de l’Alberta, cette institution a d’ailleurs été la première au monde à lancer un programme de maîtrise en administration des affaires (MBA) entièrement en ligne en 1994.
«Comme tous nos programmes sont offerts à distance, on n’a pas les mêmes contraintes d’infrastructure que les universités traditionnelles. On dit souvent qu’elles fonctionnent encore selon le modèle Blockbuster, alors que l’AU s’inspire plutôt du modèle Netflix, plus flexible et adapté au monde numérique», analyse Catherine Swindlehurst, vice-rectrice aux affaires académiques.
À l’AU, l’accessibilité repose sur le principe d’«université ouverte», où les conditions d’admission sont réduites au strict minimum, voire inexistantes. Selon la vice-rectrice, Catherine Swindlehurst, l’objectif n’est pas de transformer l’établissement en «machine à diplômes», mais bien de lever les barrières pour les étudiants dits «non traditionnels».
«On pense ici à ceux qui sont généralement exclus de l’enseignement supérieur, que ce soit en raison de leur situation personnelle, de leur lieu de résidence ou d’un handicap», précise-t-elle. Cela concerne notamment les étudiants du Grand Nord, les membres des communautés autochtones, ainsi que de nombreux professionnels qui étudient et travaillent en même temps.
D’ailleurs, 79% des 30 000 étudiants de dernière année de l’AU occupent un emploi pendant leurs études, tout comme 87,4% des étudiants aux cycles supérieurs.
L’accessibilité à l’Université d’Athabasca passe aussi par l’offre de programmes traditionnellement réservés à l’enseignement en présentiel désormais entièrement accessibles en ligne, souligne Catherine Swindlehurst. C’est notamment le cas des diplômes de deuxième cycle en formation d’infirmières praticiennes et en architecture. «C’est ce genre de programmes que les universités traditionnelles ne peuvent offrir en ligne, car elles ne sont pas encore équipées, mais nous oui», mentionne-t-elle.

Florian Meyer, professeur au département de pédagogie de la faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke et spécialiste de la formation à distance. Photo : Courtoisie
Tout dépend des apprenants
Or, avec une offre de cours entièrement en ligne et diversifiée, certains défis s’imposent. Surtout en l’absence d’un campus physique, reconnaît la vice-rectrice. Pour y répondre, l’AU mise sur la création d’occasions de réseautage et de soutien entre pairs en s’appuyant sur la technologie.
«L’un de nos étudiants à la maîtrise en administration des affaires a développé une application de réseautage spécifiquement pour les étudiants de l’AU. Nous avons aussi un modèle de tutorat très solide. Un tuteur académique est assigné à chaque cours pour assurer un soutien tant sur le plan académique que personnel. C’est une approche très personnalisée», ajoute-t-elle.
Selon Florian Meyer, ce ne sont pas tous les étudiants qui ont forcément besoin de ces mesures pour réussir, mais il est positif qu’elles soient offertes au besoin. «C’est vraiment du cas par cas, ça dépend des styles et des contextes», précise-t-il. Certains apprenants peuvent suivre une formation de façon entièrement autonome, avec des capsules préenregistrées et sans interaction, alors que d’autres préfèrent le travail en groupe et les échanges pour briser l’isolement, dit-il.
Des recherches récentes sur le bien-être numérique ont aussi démontré que certains facteurs, qui dépassent la sphère pédagogique, peuvent influencer l’engagement des étudiants qui suivent une formation à distance. «Je pense à la distraction causée par les téléphones cellulaires, à l’ergonomie ou encore au contexte familial, qui peuvent faire en sorte que des apprenants ne soient pas autant investis que souhaité», analyse le spécialiste.
Dans la même logique, il ne semble pas avoir de modèle unique – synchrone, asynchrone, hybride – meilleur qu’un autre pour favoriser la réussite. Tout dépend encore de l’apprenant et de ses besoins. Par exemple, une personne qui poursuit une maîtrise en enseignement tout en exerçant déjà son métier profitera sans doute davantage des capsules asynchrones, qu’elle peut consulter à son propre rythme, en fonction de ses contraintes. À l’inverse, le format synchrone «peut être mieux pour d’autres publics, selon leurs préférences», ajoute Florian Meyer.
Différentes formules pour les apprenants
Formation synchrone : cours en ligne donnés en direct, avec interaction en temps réel entre enseignants et étudiants, souvent par visioconférence.
Formation asynchrone : cours en ligne accessibles en tout temps; les étudiants avancent à leur rythme, sans horaire fixe.
Formation hybride : modèle qui combine synchrone et asynchrone ou qui alterne cours en ligne et en présentiel.

Amel Ben Ammar poursuit en ligne un baccalauréat après diplôme en éducation secondaire au Campus Saint-Jean. Photo : Courtoisie
Amel Ben Ammar fait partie de ces étudiants pour qui la formation en ligne a été une véritable bouée de sauvetage. Originaire d’Algérie, où elle enseignait à l’université, elle poursuit aujourd’hui un baccalauréat après diplôme en éducation secondaire au Campus Saint-Jean (satellite), tout en travaillant à temps plein pour le Portail Immigrant Association (PIA).
Pour elle, la flexibilité offerte par les cours à distance est essentielle pour concilier travail et études. «Ça m’a beaucoup aidée», souligne-t-elle. «Je travaille toute la journée et j’étudie le soir. Comme tout nouvel arrivant, j’ai besoin de travailler pour subvenir aux besoins de ma famille», ajoute-t-elle.
Elle apprécie également de pouvoir avancer à son propre rythme, éviter les déplacements et revoir les cours enregistrés au besoin. «Parfois, quand je n’ai pas compris certains éléments, je peux réécouter les enregistrements», précise-t-elle.
Si suivre une formation à distance demande «une certaine discipline et une aisance minimale avec la technologie», Amel Ben Ammar demeure convaincue des avantages du modèle. Inspirée par son expérience, elle souhaite même intégrer des forums de discussion, similaires à ceux utilisés dans ses cours, dans ses propres pratiques pédagogiques. «De mon côté, je ne vois vraiment pas de négatif.»

Catherine Swindlehurst est vice-rectrice aux affaires académiques à l’Université d’Athabasca. Photo : Courtoisie
Entre fragilité et innovation
Néanmoins, Florian Meyer rappelle que la formation à distance comporte certains points de tension, notamment avec l’émergence de l’intelligence artificielle. Bien que la tricherie ait toujours existé, elle est devenue beaucoup plus accessible depuis l’apparition d’outils comme ChatGPT ou Gemini, et plus encore dans un contexte d’enseignement en ligne, souligne-t-il.
«Certains établissements optent pour des examens surveillés à distance, avec des systèmes de caméras, afin de limiter la triche», indique-t-il. De son côté, il privilégie des stratégies pédagogiques pour prévenir les abus. «L’idée est d’organiser les travaux de manière qu’ils ne soient pas une répétition de savoirs simples qui se trouvent facilement, mais qui vient chercher un contexte qui ne peut être répliqué de n’importe quelle manière.»
Il demande aussi régulièrement à ses étudiants de produire un travail individuel à la fin de chaque trimestre, puis de venir en faire une présentation orale devant la classe. Selon lui, cet exercice permet de mieux évaluer leur compréhension réelle. «Lorsqu’on pousse un apprenant à expliquer clairement et spontanément un sujet, il devient plus facile de déceler les lacunes.»
Cela dit, le professeur estime que la plupart des universités offrant des programmes en ligne adoptent encore une forme de «politique de l’autruche» face aux enjeux posés par l’intelligence artificielle. «Pour l’instant, on fait confiance aux étudiants, mais ce n’est pas suffisant», explique-t-il.
Malgré les enjeux qu’elles posent, les nouvelles technologies pourraient aussi transformer en profondeur la formation en ligne. Florian Meyer travaille notamment à développer des environnements d’expérimentation à distance grâce à la réalité virtuelle. «J’ai vu des choses très intéressantes en médecine, raconte-t-il. Avec un casque de réalité virtuelle, j’avais accès à une opération de chirurgie cardiaque comme si j’étais le médecin. Je pouvais interrompre l’opération, poser des questions et comprendre pourquoi certains gestes étaient posés et d’autres non.»
L’Université Athabasca suit elle aussi de près ces avancées. La réalité virtuelle est déjà intégrée dans son programme d’architecture, et d’autres projets sont en réflexion. «Nous avons d’importantes conversations sur l’évolution des technologies et sur la manière de les intégrer de façon réfléchie dans nos programmes», souligne Catherine Swindlehurst.
Pour elle, le véritable enjeu sera d’adopter ces outils sans jamais perdre de vue l’essentiel : les besoins réels des apprenants.
Glossaire – Panacée : Remède universel