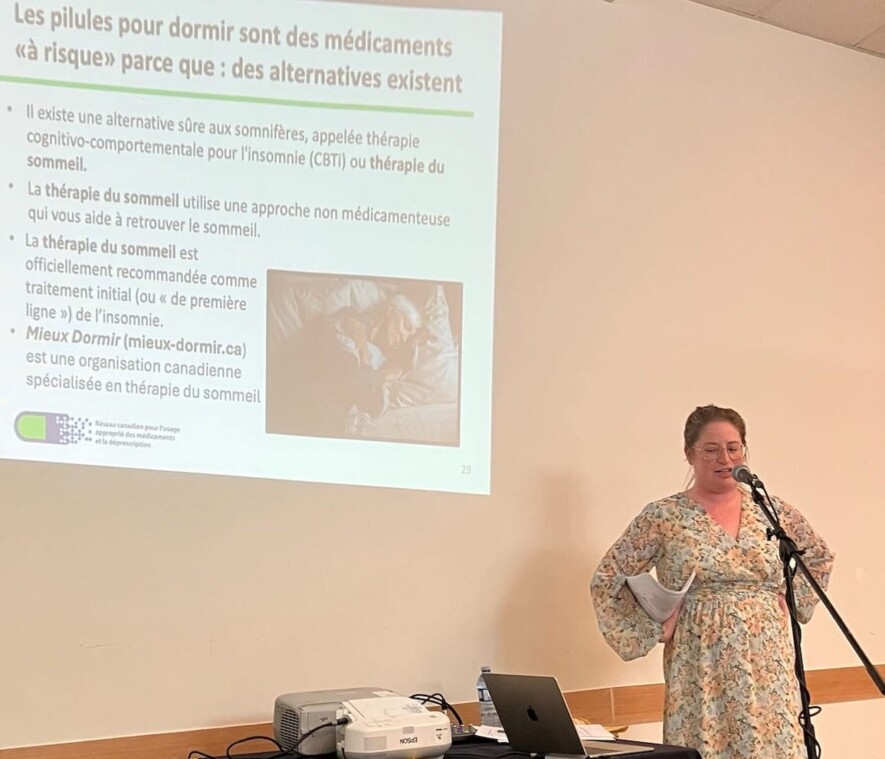Dre Emily McDonald est professeure agrégée de médecine interne à l’Université McGill et directrice du ReCAD. Photo : Courtoisie
Les aînés sont les plus exposés à la polymédication, constate Dre Emily McDonald, professeure agrégée de médecine interne à l’Université McGill et directrice du Réseau canadien pour l’usage approprié des médicaments et la déprescription (ReCAD). «Beaucoup de personnes âgées accumulent les ordonnances au fil des années, parfois même des décennies, sans qu’une révision complète de leurs traitements soit effectuée», souligne-t-elle.
Le réseau qu’elle dirige milite pour que la déprescription devienne un réflexe clinique, au même titre que la prescription. Il ne s’agit pas nécessairement d’interrompre un traitement, précise-t-elle, mais parfois d’en réduire la dose ou de le remplacer par une option jugée plus sécuritaire et mieux adaptée.
Car derrière chaque pilule se cache un équilibre fragile entre bienfaits et risques. Si la majorité des médicaments visent à soulager ou à stabiliser des maladies chroniques comme le diabète ou les troubles cardiovasculaires, leur multiplication peut aussi faire plus de tort que de bien. Dre McDonald rappelle d’ailleurs que la prise de plus de cinq médicaments augmente considérablement le risque d’effets indésirables.
Parmi les traitements souvent pointés du doigt, les somnifères et les inhibiteurs de la pompe à protons utilisés contre le reflux gastrique. «J’ai eu des patients dont les troubles de mémoire étaient attribués à tort à une démence, raconte-t-elle. Mais après avoir arrêté leurs somnifères, leurs fonctions cognitives se sont nettement améliorées.» Pour d’autres, ce sont des enjeux d’équilibre qui se sont réglés. «Certains faisaient des chutes à répétition. Une fois certains médicaments retirés, leur stabilité s’est rétablie», ajoute-t-elle.
Au-delà de la santé physique, la déprescription peut aussi alléger la facture des aînés liés aux coûts parfois importants des médicaments et aussi améliorer leur appétit, note la spécialiste.
J’ai eu des patients dont les troubles de mémoire étaient attribués à tort à une démence
Un atelier instructif
Parmi les personnes réunies à Edmonton pour l’événement Vivre actif de la FAFA, Odile Rollin, membre du Club de l’Amitié, a choisi d’assister à l’atelier sur la déprescription offert par le ReCAD. «Moi, je ne prends pas grand-chose, mais pour certaines personnes, j’imagine que ça va les inciter à faire un suivi. On a aussi appris qu’en Alberta, il y avait la possibilité de prendre rendez-vous avec notre pharmacien pour aller justement revoir notre liste de médicaments et nos dosages de manière tout à fait gratuite», confie-t-elle.
Si elle salue la pertinence de l’atelier, Mme Rollin aurait toutefois souhaité qu’il aborde aussi les limites de la déprescription, notamment lorsque des aînés décident d’arrêter un traitement sans supervision médicale. «Je crois qu’on connaît tous des personnes âgées qui choisissent d’elles-mêmes de ne plus prendre certains médicaments parce qu’elles se sentent mieux ou estiment que le traitement a fait son effet. Mais cela peut aussi poser beaucoup de risques. J’aurais aimé qu’on en parle davantage», souligne-t-elle.
Pour le reste, la participante se dit ravie d’avoir pris part à l’événement de la FAFA qui combinait conférences, activités physiques et moments de socialisation pour les aînés franco-albertains réunis à Calgary à la fin septembre. «C’était formidable!», lance-t-elle avec enthousiasme.
Dre Emily McDonald précise, quant à elle, que la déprescription doit absolument être encadrée par les conseils d’un pharmacien, d’un médecin ou d’une infirmière praticienne. «Normalement, c’est un processus qui est amorcé entre un professionnel de la santé qui peut prescrire ou déprescrire et le patient et sa famille. Parfois, c’est le patient ou la famille qui initie la discussion, mais le professionnel encadre la démarche», explique-t-elle.
Je crois qu’on connaît tous des personnes âgées qui choisissent d’elles-mêmes de ne plus prendre certains médicaments […]. Mais cela peut aussi poser beaucoup de risques. J’aurais aimé qu’on en parle davantage
En parler ouvertement
À l’inverse, certaines personnes âgées hésitent à modifier leurs ordonnances surtout lorsqu’elles prennent les mêmes médicaments depuis de nombreuses années, observe la directrice du ReCAD. Selon elle, le rôle du professionnel de la santé est alors d’adopter une approche rassurante et transparente en expliquant les effets possibles du processus pour que la démarche se fasse dans l’intérêt du patient.
«Il faut avoir une discussion éclairée sur le sujet, insiste-t-elle. Quels sont les risques d’arrêter le médicament? Qu’est-ce que le patient va ressentir? Est-ce que des symptômes vont apparaître? Et comment les gérer si c’est le cas?» Des questionnements essentiels à une démarche efficace, selon elle.
L’arrêt d’un somnifère, par exemple, peut temporairement entraîner des difficultés d’endormissement ou accentuer l’anxiété. Pour limiter ces effets, Dre McDonald recommande très souvent une réduction progressive, étalée sur trois ou quatre mois.
Si la déprescription s’adresse principalement aux aînés, elle suscite aussi un intérêt croissant auprès d’autres groupes fortement médicalisés, comme les personnes atteintes de maladies chroniques, du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ou de troubles rhumatologiques.
Ces patients, souvent suivis par plusieurs spécialistes, peuvent accumuler les ordonnances sans qu’un professionnel fasse le point sur l’ensemble de leurs traitements. «Il arrive qu’un médicament soit ajouté pour contrer les effets secondaires d’un autre, puis qu’on perde de vue la raison initiale de la prescription», conclut la spécialiste.
Il arrive qu’un médicament soit ajouté pour contrer les effets secondaires d’un autre, puis qu’on perde de vue la raison initiale de la prescription
Le ReCAD propose des outils pratiques et des guides pour mieux comprendre la déprescription et en discuter avec votre médecin ou votre pharmacien.
Glossaire – Polymédication : prise de plusieurs médicaments différent