
Une francophonie plurielle
Depuis vingt ans, la francophonie albertaine se transforme et s’élargit. En 2021, Statistique Canada rapportait que près de 30% des francophones dans la province étaient issus de l’immigration. Notre communauté est ainsi devenue une mosaïque d’histoires et de parcours. Ce numéro célèbre cette richesse, moteur de vitalité, tout en donnant voix aux enjeux qui l’accompagnent.
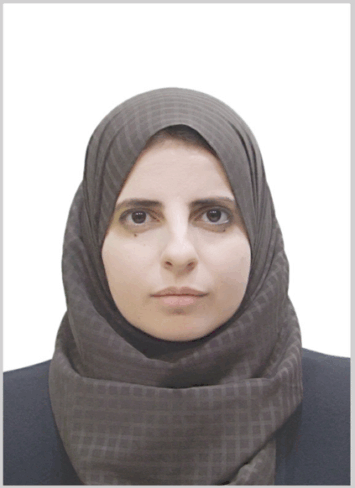
Amina Imouloudene, médecin spécialiste en réadaptation venant d’Algérie, attend toujours de pouvoir pratiquer en Alberta. Photo : Courtoisie
Amina Imouloudene était médecin spécialiste en réadaptation jusqu’à son arrivée en Alberta comme résidente permanente en juillet 2024. Formée en Algérie, elle a été parmi les premières à intégrer le groupe de soutien mis en place par le RSA en collaboration avec Jean Tenaguem, responsable du développement dans le sud de la province.
«Je me sentais très seule et isolée. Ça m’a rassurée de voir qu’il y a, en fait, pas mal de médecins francophones qui ont récemment atterri en Alberta et qui vivent la même situation que moi», raconte-t-elle.
Le groupe lui a permis d’aller chercher la motivation dont elle avait besoin pour continuer à avancer et à faire face à des défis de taille, explique-t-elle, tout en gardant espoir. Le premier qui s’est rapidement imposé à elle a été la langue. En effet, dans la province albertaine, même les praticiens formés en français doivent obligatoirement réussir un examen de compétence linguistique en anglais pour obtenir leur permis d’exercice dans la province.
Une exigence qui rallonge le parcours et constitue une barrière supplémentaire, souligne Mme Imouloudene. «Je suis actuellement des cours d’anglais à l’Université de Calgary pour améliorer mon niveau. Je n’ai même pas encore entamé la préparation des examens et, après un an, je me retrouve toujours au bas de l’échelle. Je savais que le processus serait difficile, mais vivre l’expérience, c’est encore plus difficile», mentionne-t-elle.
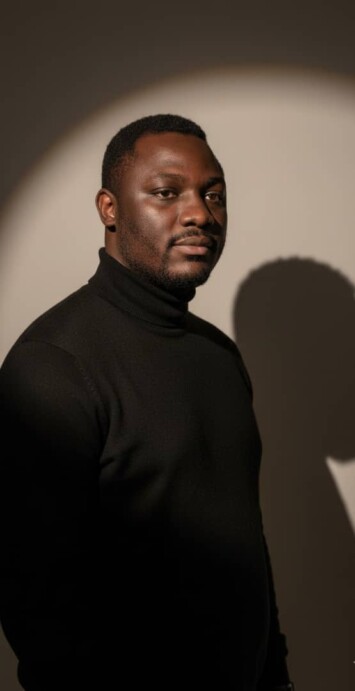
Paul Fernand Ehongo aimerait que le parcours pour obtenir un droit de pratique en Alberta soit moins complexe. Photo : Courtoisie
Ceux qui se ressemblent s’assemblent
Paul Fernand Ehongo traverse un parcours similaire. Médecin de famille formé au Cameroun, il s’est établi en Alberta, il y a trois ans. «Pour nous, les francophones, je veux être franc : on se sent un peu abandonnés», lance-t-il à son tour.
Avant de rejoindre le groupe de soutien du RSA, il vivait, lui aussi, beaucoup de découragement, notamment en raison du manque de clarté et l’ampleur des étapes à franchir pour obtenir son droit de pratique en Alberta.
Pour la majorité des médecins formés à l’étranger, le processus comprend la réussite de l’examen d’aptitude du Conseil médical du Canada (MCCQE, partie I), de l’examen clinique de la Collaboration nationale en matière d’évaluation (NAC-OSCE) et, dans plusieurs cas, un passage obligé par une résidence.
«C’est un long processus. Il y a le stress moral, le stress familial et le stress financier… Vous savez, je n’ai pas voyagé seul. J’ai une famille à laquelle je dois subvenir», partage-t-il.
À ces contraintes s’ajoute une règle lourde de conséquences : le College of Physicians & Surgeons of Alberta (CPSA) prévoit que les démarches pour obtenir le droit de pratique soient complétées dans un délai de trois ans. Passé ce cap, les médecins peuvent rencontrer des problèmes pour obtenir leur licence et doivent souvent se soumettre à une évaluation ou à une formation supplémentaire pour actualiser leurs compétences.
Un standard jugé irréaliste par M. Ehongo, qui travaille actuellement pour Uber et dans un supermarché No Frills afin de subvenir aux besoins de sa famille. «Si je devais me consacrer à temps plein à ce processus, peut-être que ce serait faisable. Mais je n’ai pas ce luxe», explique-t-il.
Il envisage même de retourner temporairement exercer dans son pays d’origine pour ne pas perdre ses acquis. «Si c’est la seule manière d’intégrer l’ordre provincial de l’Alberta, je vais le faire. Mais je fais quoi pendant ce temps? Je laisse ma famille à qui?», s’interroge-t-il.
De hauts standards à relever
Là où le bât blesse, ajoutent Mme Imouloudene et M. Ehongo, c’est qu’une telle complexité contraste avec la pénurie criante de médecins – et de médecins francophones – en Alberta. Un paradoxe que ce dernier résume ainsi : «En venant au Canada, on se dit qu’on fait partie d’une immigration professionnelle, qu’il y aura un suivi, parce que les besoins sont là et que nous sommes de la main-d’œuvre après tout. Mais ce n’est pas vraiment le cas. Je pense que ce n’est pas un problème de province, mais un problème de système».
Cette réalité l’a même amené à se questionner sur sa décision d’immigrer au pays. «Mais, en même temps, tu ne peux pas arriver chez un étranger qui te reçoit et lui imposer de changer les règles de sa maison», nuance-t-il.

Jean Tenaguem est le responsable du développement dans le sud de la province pour le RSA. Photo : Courtoisie
Au sein du groupe de soutien du RSA, les témoignages sont souvent similaires à ceux d’Amina Imouloudene et de Paul Fernand Ehongo, confirme Jean Tenaguem, qui a contribué à mettre le projet sur pied et qui est, lui-même, en processus pour obtenir son droit de pratique en Alberta.
«C’est assez récurrent pour tous les membres de vivre des expériences comme celles-là, moi y compris. D’ailleurs, nous étions huit participants en janvier et maintenant, nous sommes trente et un. Ça démontre bien que nous sommes plusieurs à vivre cette réalité», dit-il.
Pour la majorité des participants, le fait de discuter de l’ampleur des procédures brise l’isolement, mais agit aussi comme effet motivateur sur leurs propres démarches. Après tout, rappelle M. Tenaguem, «tout est mis en œuvre pour nous décourager».
Et mine de rien, plusieurs membres ont franchi d’importantes étapes au cours des derniers mois, souligne-t-il. «C’est très positif.»
Pourtant, la ligne d’arrivée demeure lointaine. Même en suivant chaque étape à la lettre, sans retard ni répétition, et en disposant de toutes les ressources financières nécessaires, M. Tenaguem estime qu’il faut compter «pas moins de quatre ans» pour y parvenir. Soit un an de plus que la période de trois ans que le collège professionnel albertain prévoit dans ses propres exigences pour compléter le processus sans enclencher d’étapes supplémentaires.
Difficile de s’y retrouver
À moins qu’ils passent par un programme d’évaluation de préparation à la pratique, qui consiste en une observation clinique et une pratique supervisée, avant d’obtenir un permis, les médecins formés à l’étranger doivent être jugés admissibles par le programme AIMG (Alberta International Medical Graduate Program) pour pouvoir participer au processus de jumelage national (CaRMS) et obtenir une place en résidence en Alberta.
Les critères sont détaillés sur le site web du programme. Mais pour les médecins francophones, une difficulté s’ajoutait jusqu’à récemment : la quasi-totalité des ressources et documents d’accompagnement étaient uniquement disponibles en anglais. Heureusement, l’AIMG prévoit de traduire prochainement ses ressources en français.
«Ils comprennent que nous, les médecins francophones formés à l’étranger, nous avons des besoins spécifiques qui vont au-delà des autres médecins qui arrivent en Alberta et qui, pour la plupart, parlent déjà très bien l’anglais. Eux, ils n’ont que le défi de passer les examens», souligne M. Ehongo.
Depuis 2025, le College of Physicians & Surgeons of Alberta a aussi mis en place une approved jurisdiction route : si un médecin provient d’un pays ou d’une juridiction jugée équivalente, il peut obtenir plus rapidement un permis sans passer par l’AIMG. Par contre, cette voie est encore restreinte et ne s’applique pas à la majorité des francophones venant d’Afrique du Nord, d’Afrique subsaharienne ou d’Europe francophone.Ces parcours chaotiques sont loin d’être isolés et, pourtant, la pénurie de médecins en Alberta semble ne plus faire de doute. Une étude de l’Université de Calgary, publiée en septembre dernier dans les Annals of Family Medicine, met d’ailleurs en lumière plusieurs facteurs aggravants. Les chercheurs soulignent notamment l’effet boule de neige du vieillissement de la population et de la hausse des patients atteints de plusieurs maladies, notamment de maladies chroniques, comme le diabète, les maladies cardiaques et les troubles de santé mentale, qui mettent «une pression sur le système de santé dans son ensemble».
Glossaire – Là où le bât blesse : Le point sensible, là où le problème se trouve










